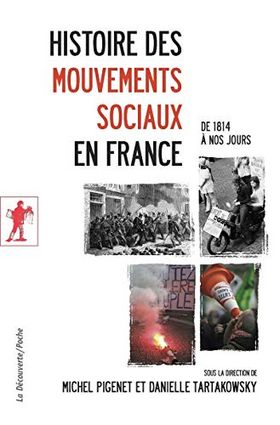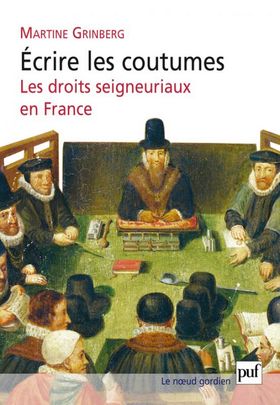Bibliothèque : 2 coups de cœur (avril 2023)
Les ouvrages présentés sont issus de la bibliothèque de conservation et sont consultables, sur place, en salle de lecture![]() (après avoir rempli les modalités d'inscription).
(après avoir rempli les modalités d'inscription).
Avril 2023
+ d'infos : "Histoire des mouvements sociaux en France : de 1814 à nos jours" par Michel PIGENET et Danielle TARTAKOWSKY. Arch. dép. du Gard : BIB BH 2864

"Cet ouvrage vient combler une lacune et relever un défi. Après que l'évanouissement des horizons d'attente a disqualifié les grands récits qui, jadis, prétendaient donner un sens aux mobilisations collectives, il semble désormais possible et nécessaire d'en entreprendre l'histoire hexagonale. Possible, car les travaux existent qui permettent d'en renouveler l'approche comme d'en explorer des aspects inédits.
Nécessaire, parce que, de nouveau, la question sociale, mondialisée dans ses causes et ses manifestations, revient en force sur le devant de la scène publique, en quête d'interprétations, de relais, de connexions et de solutions. L'histoire développée ici s'attache, du XIXe siècle à nos jours, à tous les types de mouvements sociaux - révolutions, rébellions, émeutes, grèves, campagnes électorales, pétitions, etc.
- et quels qu'en soient les acteurs - ouvriers, paysans, jeunes, catholiques, minorités sexuelles, etc. Centrée sur la France, elle n'en ignore pas les interactions coloniales et internationales. Attentive à cerner l'articulation du social avec le politique, le culturel, l'idéologique et le religieux, elle entend réintégrer les mobilisations collectives dans une histoire globale dont elles furent et demeurent des moments essentiels.
"
(Source : 4ème de couverture)
⇒ Avis de nos amateurs :
"En ce moment la France fait face à des manifestations pour contester un projet de loi. Le droit de manifester existe depuis des décennies, des siècles selon cet ouvrage. D’après les auteurs, les mouvements sociaux se sont multipliés au fil du temps. La grève est un mouvement social, une revendication, tout comme la pétition même si le but n’est pas forcément le même. Dans ce livre nous pouvons découvrir l’histoire des mouvements sociaux, qui sont nombreux et parfois même peut-être méconnus à l’heure où le pays est en grève. Un livre indispensable dans l’air du temps."
+ d'infos : "Écrire les coutumes : Les droits seigneuriaux en France (XVIe-XVIIIe siècle)" par GRINBERG, Martine. Arch. dép. du Gard : BIB BH 2265

"En l’an 1613, les habitants de Falon portent plainte au bailliage de Vesoul contre leur seigneur. Ils ont toujours dansé le jour de Pentecôte dans un pré, de leur plein gré, et non sur injonction seigneuriale. Là est l’objet du litige et le point de cette enquête dans le monde des redevances seigneuriales curieuses : […] Comment nommer ces droits, comment qualifier les faits pour pouvoir juger ? Droits bizarres, diront les juristes. Les seigneurs ont-ils vraiment les titres requis pour s’en prévaloir ? Ils devront le prouver.
Car, à partir de la mise en écrit des coutumes entamée en France depuis le milieu du XVe siècle, s’amorce une réflexion sur le champ de compétence, le contenu et les catégories du droit coutumier, et en particulier sur les droits seigneuriaux.
L’enquête menée ici sur une foison de cas surprenants s’oriente alors vers la manière dont les juristes dans leur travail d’interprétation, ont tenté de penser la féodalité (et le droit féodal) jusque dans ses formes rituelles, les « vaines cérémonies » dont parlait Marc Bloch. L’écriture du droit offre ainsi une grille de lecture magistrale pour rendre compte du passage de la féodalité à la modernité : le nouveau statut de la preuve mis en place au XVIe siècle et le formalisme juridique ont bien leur part dans la construction de l’État monarchique moderne."
(Source : éditeur)
⇒ Avis de nos amateurs :
"Des paysans portant plainte contre leur seigneur ? Impossible ! Cela va à l’encontre de l’idée générale de l’absolue soumission des vassaux envers leur suzerain. Pourtant, c’est ce que démontre l’autrice : les habitants refusent de se laisser abuser.
Dans l’affaire de Falon, le sujet peut sembler futile voire absurde. Il s’y cache en réalité un enjeu important : la distinction fondamentale entre un droit et un devoir. Les vassaux reconnaissent, s’ils souhaitent danser, devoir offrir une rose au seigneur. Celui-ci, néanmoins, n’a pas l’autorité requise pour les obliger à danser sous peine d’une amende. Pour les habitants, ce n’est pas le fait de danser qui pose ici problème mais bien les limites du pouvoir du suzerain.
Cette anecdote, avec tant d’autres, pose la question d’un règlement défini, codifié et écrit. Le passage de la coutume orale à la rédaction permet d’ancrer le droit dans la réalité. Ces litiges rendent cette codification nécessaire pour apporter les réponses adéquates aux affaires. L’autrice explique alors les difficultés et le travail complexe que cette entreprise demande aux juristes.
C’est alors les balbutiements du droit moderne."