Nos grands-parents dans la Grande Guerre - 1914 - Les moissons interrompues
Commémoration du centenaire de l’entrée en guerre

Cette exposition, issue d’un partenariat entre l’ONAC-VG, l’association du Club d’Histoire Au Travers des Objets (CHATO) et les Archives départementales du Gard, avec le soutien du Musée 1900 d’Arpaillargues et du Musée du scribe de Saint-Christol-les-Alès (Gard), a été visible jusqu’au 12 juin 2015 sur le site des Archives départementales du Gard.
Le catalogue reprend les thématiques de l’exposition, ainsi que les parcours de combattants présentés. Il s’agit d’un long et sérieux travail collectif de l'ensemble de l'équipe des Archives départementales du Gard, dont les premiers retours, visiteurs et lecteurs, sont vraiment très positifs.
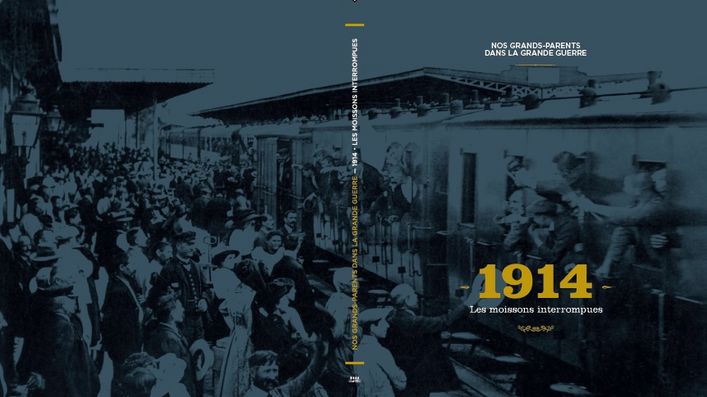
Avant propos du catalogue
Les horreurs de la Seconde Guerre mondiale n'ont jamais effacé celles de la Première. Encore aujourd'hui, 1914-1918 reste la « Grande Guerre ». Pas seulement à cause des pertes, énormes, mais sans doute aussi parce que, pour la première fois dans notre histoire, c'est toute la population française qui s'est trouvée impliquée pendant des années. Sur le front, ces « poilus » qui combattaient, mouraient, étaient blessés ou faits prisonniers, ils étaient paysans, ouvriers, instituteurs, étudiants. Ils étaient parfois poètes, comme Apollinaire, Péguy ou ce Jean de La Ville de Mirmont dont un roman de Jean Garcin, prix Jean Carrière 2013, nous a récemment rappelé la brève et émouvante histoire, car c'est toute une génération des lettres et des arts français qui est passée au feu. Ici même, dans un des départements les plus éloignés du front, chaque famille attendait des lettres et pleurait des morts, tout en faisant tourner une économie bouleversée, en accueillant les réfugiés de la zone des combats, en survivant malgré les restrictions, en trouvant encore de quoi financer les œuvres et emprunts de guerre.
Or, ces familles, ce sont les nôtres : les lettres et les photographies sont dans nos armoires, ce sont nos noms qui figurent sur les monuments aux morts. En un sens, cette guerre où furent entraînés hommes, femmes, enfants et jusqu'aux animaux, nous l'avons tous connue.
On comprend que la Mission du Centenaire, créée en 2012 auprès du secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire, ait à coordonner et labelliser plus de 2000 projets en France et dans le monde. Expositions, colloques, publications revisitent une époque qui conserve encore bien des énigmes, à commencer par celle-ci : comment avons-nous pu ? Et pendant quatre ans ? Malgré les ligues pacifistes, malgré Jaurès, la France de la « Belle Epoque » était certes un pays ultra-militarisé. Pourtant, on sait aujourd'hui que l'image des mobilisés, lors des moissons interrompues de 1914, partant tous la fleur au fusil, est un mythe... Alors ?
L'exposition présentée par les Archives départementales du Gard ne prétend pas résoudre ces énigmes, mais raconter comment le Gard et les Gardois ont vécu cette mobilisation de tout un pays. Afin de ne pas se limiter à la présentation des sources écrites et iconographiques – pourtant très riches en elles-mêmes – ce projet ne pouvait être réalisé qu'en collaboration. Il est donc tripartite : y participent le service départemental de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et le Club d'Histoire Au Travers des Objets (CHATO), basé à Saint-Gilles, qui présente un extrait de ses collections.
Plus généralement, le département du Gard, en développant sa politique pour l'accès de tous à son patrimoine historique et culturel, ne pouvait manquer de valoriser ce qui, en lui, porte les marques de 1914-1918. D'autres opérations sont ainsi en cours aux Archives. Le classement des archives des services préfectoraux créés à l'occasion de la guerre (ravitaillement, assistance aux familles, aux prisonniers, aux réfugiés...) mettra à disposition des chercheurs de nouvelles sources historiques. La numérisation des matricules de la conscription, soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication, permettra ce qui est déjà fait dans de nombreux départements : la mise sur Internet des états de services des mobilisés. La Grande Collecte, autre projet national, a incité de nombreux Gardois à prêter aux Archives leurs souvenirs : lettres, carnets... qui sont eux aussi en cours de numérisation pour être mis en ligne sur le site europeana1914-1918.fr. Enfin, une autre exposition est d'ores et déjà prévue pour 2018, sur la sortie et les séquelles de la guerre.
Pour que nous n'oubliions pas... A ceux qui, dans ces recherches et ces commémorations, verraient une exaltation de la vie du poilu, voire un romantisme de la guerre, rappelons que le devoir de mémoire consiste avant tout à rechercher la vérité : cette vérité au nom de laquelle, dans un film célèbre, on voyait ceux de 14 sortir de leurs tombes et reformer leurs rangs. Le film est d'Abel Gance, date de 1919 et s'intitule J’accuse.
Jean Denat
Président du Conseil général du Gard
Vice-Président de la Région Languedoc-Roussillon
Introduction du catalogue
Le département du Gard n’a pas été le théâtre d’opérations militaires durant la Grande Guerre, aucune bataille, aucun combat ne s’étant déroulé sur son territoire. Les Archives départementales du Gard ne collectent pas d’archives militaires à proprement parlé, produites par les différentes composantes et unités des armées de terre et de mer et conservées dans leur intégralité par le service historique de la défense. En revanche le Gard dispose d’un fonds d’archives administratives riche de témoignages sur cette période de l’histoire. A ces documents, affiches, photos, cartes postales, journaux, sont venus s’ajouter des archives privées issues de la Grande Collecte, ainsi que de pièces prêtées par le Club Histoire Au Travers des Objets et par des collectionneurs privés.
Grâce à cet ensemble, les Archives départementales du Gard ont choisi de présenter au public un parcours muséal et scientifique retraçant la période historique de la fin du XIXème siècle jusqu’à celle du milieu des années de guerre. Grâce à la richesse de ce patrimoine et de cette mémoire gardoise, tout au long du cheminement de l’exposition, l’aspect humain du conflit est mis en lumière au travers de parcours individuels de soldats.
La première partie de cet ouvrage dresse un état des lieux territorial et institutionnel de la situation militaire en France après la défaite de la guerre de 1870. Elle aborde les grandes réformes législatives et réorganisations qui s’en suivront jusqu’en 1914, visant à moderniser l’armée et à préparer son commandement et ses troupes à un futur conflit, notamment en perfectionnant les phases du recensement et en augmentant la durée du service militaire. Cette montée en puissance se traduira notamment dans le Gard, intégré à la 15ème RM (région militaire), par une implantation et une présence armée renforcée.
Ces grands changements, en particulier la loi des 3 ans, ne seront pas sans conséquences. Les élites, ainsi que la population gardoise, ont participé aux débats sur cette loi. À travers cet épisode politique, l’orientation politique du département à la veille de la Première Guerre mondiale (cinq députés sur six sont socialistes dont quatre appartiennent à la Section française de l’Internationale ouvrière), l’implantation du syndicalisme (formation de l’Union des syndicats confédérés du Gard, des bourses du travail), le poids de la presse régionale ainsi que la place de l’association pacifiste « La paix par le droit », créée en 1887 par six lycéens nîmois, auront des retombées politiques, syndicales et sociales dans tout le département.
1914 est marqué par le déclenchement du conflit armé, la mobilisation générale et dans les premiers jours, les départs des gardois regroupés dans les gares vers les dépôts puis le front de l’Est. Au travers la trame du déroulement des opérations militaires d’août, la deuxième partie du catalogue reviendra sur ses conséquences humaines, régionales et politiques, en particulier sur l’affaire du 15e corps d’armée. Quelques jours après les départs, ces mêmes gares verront passer ou s’arrêter des trains de prisonniers, de blessés ou de réfugiés. La guerre, contrairement aux prévisions très optimistes des états-majors, s’enterre. Le retour des soldats n’est plus d’actualité. L’arrière s’organise, des structures se mettent en place afin d’assurer l’accueil de ces populations
Cette thématique large de la vie à l’arrière de 1914 à 1916 est développée dans une troisième partie. Avec un quotidien immédiatement bouleversé par le départ des hommes valides, et un monde du travail privé de sa force compte tenu de la réquisition des animaux, les familles, les femmes et les enfants, sont contraints d’assurer désormais leurs moyens de subsistance et d’assurer les prochaines récoltes agricoles, les vendanges, l’extraction du charbon. Les communes rurales et minières du Gard, malgré les mesures prises, sont confrontées à la pénurie de main d’œuvre, aux difficultés de ravitaillement, à l’appauvrissement de la population. Le système éducatif axé sur une propagande patriotique, les déplacements quotidiens des populations civiles raréfiés et contrôlés, l’information jugulée par la censure bouleversent profondément et durablement la société.
Devoir national, la solidarité s’organise du plus haut au plus petit niveau, avec les campagnes d’emprunts nationaux, l’épargne du Trésor et les nombreuses initiatives associatives destinées à récolter des fonds ou des biens pour les soldats.
Ce sont sur l’évocation de ces actions humaines positives que se termine l’évocation de la première période la guerre dans le Gard.
La seconde exposition, programmée pour 2018, année de clôture des commémorations du centenaire, permettra d’écrire la suite de l’histoire de la Grande Guerre dans le département et couvrira la période de 1917 aux années 1920, en développant les thématiques des privations, des crises, du deuil, des retours, de souvenir et des conséquences du conflit.




